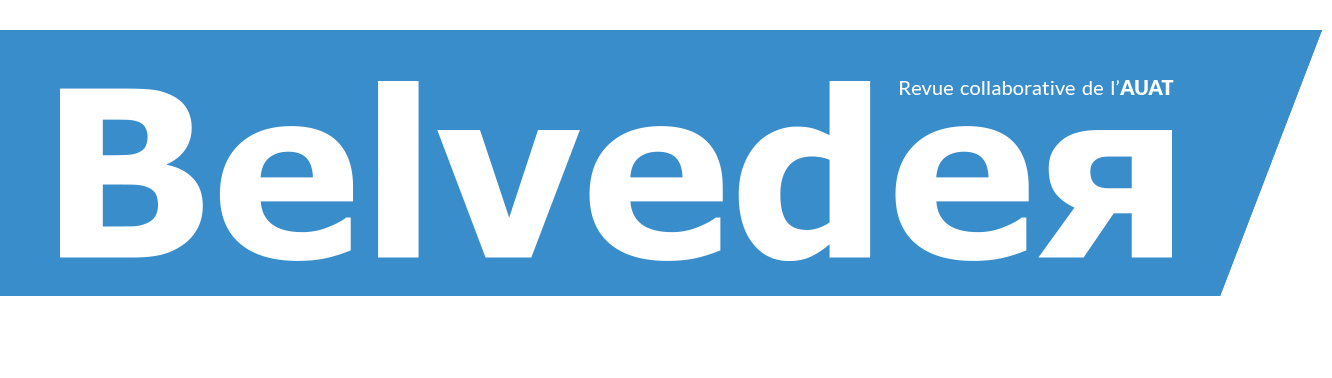Téléchargez l’article au format PDF
Marina CASULA
Maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Toulouse 1 Capitole, membre de l’Institut du Droit de l’Espace, des Territoires, de la Culture et de la Communication (IDETCOM)
Selon l’Insee, au 1er janvier 2022, 21 % de la population française avait 65 ans ou plus (dont 57 % de femmes) . À l’horizon 2040, cette proportion devrait atteindre un quart de la population. Le vieillissement de nos sociétés ouvre la voie à de nombreuses questions, notamment celles liées à l’habitat, ainsi qu’aux choix individuels et collectifs qui peuvent permettre aux personnes âgées de maintenir leur autonomie individuelle et décisionnelle.
Vieillir à domicile est à la fois un enjeu pour les politiques publiques et un souhait pour la très grande majorité des personnes concernées. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, a défini l’accompagnement à domicile parmi ses priorités « pour que les personnes âgées puissent vieillir dans de bonnes conditions ». Conçu pour ces personnes et leurs proches en recherche d’informations, le portail « Pour les personnes âgées » présente les différentes aides, dispositifs et services mobilisables afin de rester le plus longtemps possible « chez soi ». En effet, 87 % des personnes de 65 ans et plus interrogées lors d’un sondage Harris publié en 2024[1] souhaitent continuer à vivre chez elles malgré les difficultés qu’elles pourraient rencontrer dans leur vie quotidienne et qui pourraient nécessiter un accompagnement par leur entourage (famille, voisinage, services d’aide à domicile), voire une adaptation de leur domicile.
C’est d’ailleurs une réalité. Selon une étude de l’Insee parue en février 2025[2], la très grande majorité des personnes de 65 ans et plus vivent à domicile (les deux tiers en couple et un tiers seules). La proportion de personnes âgées vivant seules augmente avec l’âge. Les plus de 85 ans vivent ainsi principalement seuls (45 %), sauf dans certains territoires où ils vivent plus souvent en couple ou avec des proches (Sud-Ouest, DOM et Corse notamment). Par ailleurs, le passage à la retraite peut s’accompagner de mobilités résidentielles[3], que ce soit pour accéder à un logement plus adapté à sa situation financière ou de santé, se rapprocher de sa famille, ou encore changer de cadre de vie. L’entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou maison de retraite augmente avec l’âge, du fait du développement de certaines pathologies qui impactent fortement les besoins d’aide et de soins et/ou en lien avec l’isolement des personnes.
À partir des années 2013-14, le développement de la silver économie a encouragé la mise en place de filières de production de logements spécifiques. Ainsi, de plus en plus d’opérateurs publics et privés (promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, acteurs associatifs, parfois en lien avec des collectivités locales) proposent des solutions pour « l’habitat senior » (hors Ehpad, non abordés dans cet article) : résidences autonomie, résidences services, béguinages[4], maisons partagées, habitats inclusifs, etc.
Si vivre dans cet entre-soi générationnel est parfois un choix, motivé par le sentiment d’une spécificité du vécu associé à l’avancée en âge, il peut à l’inverse être subi, induisant ou renforçant un sentiment d’éloignement des générations amenées à décohabiter et/ou à avoir des modes et des temporalités de vie différenciées. Aussi voit-on certaines résidences autonomie expérimenter l’accueil de jeunes, tant pour répondre aux besoins de logements qu’ils et elles rencontrent sur certains territoires, que pour renouer des liens intergénérationnels parfois distendus.
À côté de ces lieux de vie « dédiés » aux personnes âgées, les habitats intergénérationnels constituent des alternatives qui permettent de préserver ou de retisser des liens entre générations.
Le développement de cohabitations intergénérationnelles
Mettant en avant la solidarité et l’entraide intergénérationnelle, la cohabitation intergénérationnelle vise à lutter contre l’isolement social des personnes âgées, voire contre celui des plus jeunes (en études ou en emploi, plus ou moins loin de leur famille et de leurs cercles amicaux), tout en répondant aux besoins de logement des uns et des autres. On peut donc les envisager comme des « chez-soi » qui sont aussi des « chez-nous », mais dans un autre cadre que la cohabitation intrafamiliale, dont on a vu précédemment qu’elle persiste davantage dans certains territoires.
Le principe des cohabitations intergénérationnelles peut sembler simple : une personne âgée propose une chambre à titre gratuit ou contre un loyer modeste. En échange, la personne jeune accueillie s’engage à consacrer une part de son temps à la personne âgée (repas en commun, par exemple). Cela ne peut néanmoins se substituer à une aide à domicile classique ou à un accompagnement socio-médical dans le cadre de la perte d’autonomie, par exemple. Si de nombreuses associations promeuvent ce type d’entraide intergénérationnelle (depuis le début des années 2000 pour certaines, comme l’association Mieux ensemble sur le territoire toulousain ou le réseau Cohabilis à l’échelle nationale), la loi ÉLAN[5] du 23 novembre 2018 est venue encadrer ce concept officiellement dénommé « cohabitation intergénérationnelle solidaire ». Elle insiste ainsi sur le caractère solidaire de ce type d’habitat (si des loyers sont versés par les jeunes, ceux-ci restent modestes) qui vise à renforcer le lien social entre des jeunes de moins de 30 ans et des personnes âgées de 60 ans et plus, propriétaires ou locataires de leur logement (dans ce dernier cas, on parlera alors plutôt de colocations intergénérationnelles). La loi définit également un cadre juridique et fiscal spécifique à ce type de colocation. Elle s’accompagne par ailleurs d’une « charte nationale de la cohabitation intergénérationnelle solidaire ».
Les autres formes d’habitats intergénérationnels sont constituées de logements privatifs (en location, en accession à la propriété ou en pleine propriété), intégrés dans des collectifs (immeubles ou maisons partagées) où les espaces communs (jardins, cour- sives, salles communes, buanderies partagées, etc.) sont conçus pour animer et faire vivre les projets de rencontre et de partage intergénérationnel. Il existe ainsi des habitats inclusifs intergénérationnels et des habitats participatifs intergénérationnels.
L’habitat inclusif intergénérationnel
L’habitat inclusif est également défini dans le cadre de la loi ÉLAN. Reposant sur un projet de vie sociale et partagée, il s’adresse en particulier aux personnes âgées et/ou en situation de handicap. Pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), il s’agit d’un type d’habitat « accompagné, partagé et inséré dans la vie locale ». Il existe une diversité d’habitats inclusifs dont l’objectif commun est de favoriser le maintien de l’autonomie dans un logement personnel tout en prenant part à une vie collective grâce à des espaces et des moments de vie partagés. Les personnes peuvent en outre bénéficier d’un accompagnement individualisé en fonction de leurs besoins (services de soins à domicile, etc.). Pour cela, elles ont accès à des financements spécifiques, tels que le forfait habitat inclusif, ainsi qu’à des prestations d’aide à la vie partagée disponibles depuis 2021 dans certains départements, comme la Haute-Garonne. Ces prestations servent le plus souvent à financer de l’animation (en articulation notamment avec une « charte de la vie partagée ») afin de créer des liens entre des personnes venant d’horizons parfois très divers. Enfin, certains habitats inclusifs intègrent la dimension intergénérationnelle, comme les projets portés sur le territoire toulousain par l’association Habitat et Humanisme.
L’habitat participatif intergénérationnel : « vieillir en solidarité »[6]
La solidarité, la préservation des liens intergénérationnels et la lutte contre l’isolement des personnes âgées (ou des plus jeunes) sont également au coeur des habitats participatifs intergénérationnels. Si ces formes d’habitats existent depuis de très nombreuses années, le terme « habitat participatif » a fait l’objet d’une formalisation juridique en 2014 dans le cadre de la loi ALUR[7].
Habitat Participatif France précise qu’« un habitat participatif est conçu collectivement par un groupe de personnes, qui se rassemblent pour imaginer ensemble leur habitat. Il est composé de logements individuels et d’espaces communs et mutualisés, qui sont gérés directement par ses habitant·e·s. », autour de projets solidaires et écologiques. Certains habitats participatifs émanent d’initiatives totalement privées portées par des collectifs d’habitants (avec différents statuts : copropriétés, coopératives d’habitants, associations, etc.) ou alors développées en partenariat avec des acteurs publics (bailleurs sociaux, par exemple). Plusieurs projets existent ou sont en cours de constitution à l’échelle de l’aire urbaine toulousaine.
À Toulouse, une quinzaine de personnes âgées vivant dans l’habitat participatif de 88 logements Aux Quatre Vents a pris part à la recherche action RAPSoDIÂ « Recherche Action Participative Solidarité Domicile Innovation dans l’Âge »[8]. Celle-ci visait à apporter des réponses aux questions « Penser l’autonomie par l’entraide dans la vieillesse : avec qui ? Comment ? Jusqu’où ? ». Un collectif intergénérationnel composé de quelques voisines et voisins a ainsi expérimenté une situation d’accompagnement du grand vieillissement d’un octogénaire, concrétisant ainsi « la raison d’être » du projet de solidarité intergénérationnelle de cet habitat. Cette expérience a pu être documentée dans le cadre de la recherche.
La constitution de ce collectif a permis de mettre en oeuvre des pratiques communes de care en soutien à leur voisin âgé, avec une complémentarité entre chacun au quotidien pour faire ses courses, organiser ses repas, « jeter un coup d’oeil », être attentifs aux bruits provenant de son appartement, assurer un soutien psychologique et affectif, etc. Dans ce collectif, chacun a agi selon ses possibilités, notamment temporelles, et ses capacités. La dimension spatiale de ces pratiques est également importante à considérer. Le fait de partager des espaces communs (salle commune, coursives, etc.) a permis la circulation d’informations et la coopération. L’espace est devenu ici « support du care »[9]. Cet accompagnement a duré de nombreux mois, y compris pendant l’hospitalisation de cet habitant âgé, et jusqu’à son décès à l’hôpital.
Le collectif a ainsi pu accompagner son aîné le plus longtemps possible à son domicile et au-delà. Les membres ont également pu se soutenir et partager des ressources dans cette dynamique, soulevant la question des limites individuelles et collectives rencontrées, comme celles liées à l’intimité de la personne accompagnée, au fait de ne pas s’imposer dans son espace privé, à la peur de mal faire ou aux craintes liées à la fin de vie, cela ayant amené certaines personnes à se désengager.
Cette expérience n’a pas vocation à être reproduite à l’identique. Elle est liée à un contexte, des histoires de vie et des liens propres au groupe concerné. Les pratiques peuvent varier d’une situation à l’autre, d’un collectif à l’autre. D’autres habitats participatifs intergénérationnels ailleurs en France ont également développé leurs propres dynamiques collectives d’accompagnement d’habitants vulnérables, sans pour autant avoir fait l’objet d’une analyse approfondie.
Sans pouvoir être qualifiés de « solutions miracles », les habitats intergénérationnels apparaissent comme des solutions pertinentes pour lutter contre l’isolement des personnes âgées (et des autres générations), et ainsi participer au maintien de leur autonomie. Ils constituent une forme de « domicile » parmi d’autres, une alternative solidaire, permettant également de limiter les coûts économiques du maintien à domicile en privilégiant des modes d’habiter en commun.
Bibliographie complémentaire
Maël Gauneau, Manon Labarchède et Guy Tapie, « Habitat des personnes âgées, l’intergénérationnalité au pouvoir ? », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 2022.
[1] « Les Français et le bien vieillir », enquête Toluna – Harris Interactive pour l’Observatoire santé Pro-BTP, mai 2024.
[2] En 2021, une personne de 65 ans ou plus sur trois vit seule dans son logement », Insee Première n° 2040, février 2025.
[3] « Qui vit à domicile, qui vit en établissement parmi les personnes de 60 ans ou plus ? », Les dossiers de la DREES n° 104, février 2023.
[4] Historiquement, les béguinages sont des lieux où vivaient des communautés religieuses. Aujourd’hui, certains béguinages ont été rénovés pour offrir un cadre de vie adapté aux personnes âgées. Les béguinages gardent une vocation sociale et accueillent des personnes âgées aux revenus modestes (source : portail « Pour les personnes âgées »).
[5] Loi ÉLAN : loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
[6] Anne Labit, « Habiter en citoyenneté et solidarité pour mieux vieillir », Gérontologie et société, vol. 38/149, n° 1, 2016.
[7] Loi ALUR : loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
[8] Elle a été portée par l’association Hal’âge et financée par la Fondation du Domicile, et a rassemblé un collectif d’universitaires (dont l’autrice de cet article), de personnes issues du milieu associatif et d’autres impliquées dans plusieurs habitats participatifs (ou projets) en France.
[9] Audrey Courbebaisse, Chloé Salembier, « L’espace au prisme de l’éthique du care », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine et paysagère, 2022.